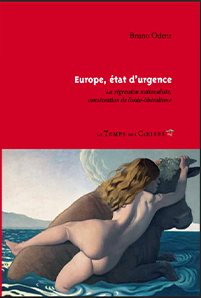En matière de politique extérieure, le président qui entame son mandat à la Maison-Blanche a promis un traitement plus multilatéral de dossiers cruciaux comme la santé et le climat. Un changement qui s’inscrit, hélas, dans une réhabilitation du « leadership » de l’hyperpuissance comme de son « usage approprié » de la force. (Décryptage in l’Humanité Dimanche du 15 au 21janvier).
Le monde va-t-il pouvoir souffler après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche ? L’heure est au soulagement pour la démocratie menacée au sein de la première puissance mondiale par un coup de force fasciste contre le Capitole. Et des motifs d’apaisement existent, nourris par le retour à une norme diplomatique plus « policée ». Ces changements programmés ne sauraient toutefois masquer les craintes suscitées par la cohérence géopolitique clairement interventionniste revendiquée par Joe Biden et son équipe.
Le plus gros émetteur de co2
La fin des cavaliers seuls trumpistes et le retour de Washington dans le concert multilatéral sur des dossiers essentiels aujourd’hui comme la santé ou le climat rassurent. On ne saurait concevoir en effet une mobilisation de la communauté internationale à la hauteur de ces défis si les États-Unis, qui sont aussi le plus gros émetteur de CO2 et le pays le plus touché par le Covid, persistaient à effectuer les bras d’honneur de « l’Amérique d’abord. »
Pour Joe Biden toutefois, ce multilatéralisme se conjugue forcément avec le plein exercice d’un « leadership » états-unien, considéré comme la garantie supérieure à la bonne marche du monde. L’Amérique se doit d’« être devant et (de) mener la marche », écrit-il dans son programme de politique étrangère, précisant qu’aucune autre nation « n’en aurait la capacité » parce qu’aucune ne serait bâtie sur « l’idée de liberté »(1). La démarche ne laisse pas augurer une désescalade dans des relations avec la Chine, qui se sont singulièrement envenimées durant le mandat Trump.
Un budget militaire historique de 750 milliards de dollars
Pis, on pourrait passer à l’exacerbation de tensions plus seulement commerciales mais politiques et/ou militaires. Avec l’achèvement du « pivot » du déploiement de la force du Pentagone, enclenché sous la présidence Obama, du Moyen-Orient vers l’Extrême-Orient. Repositionnée aux abords de la Chine, l’armada états-unienne disposera d’un budget qui vient d’être approuvé de façon bipartisane, crevant tous les plafonds historiques à 750 milliards de dollars.
La réhabilitation de l’interventionnisme est l’aspect le plus préoccupant de la « normalisation » géostratégique. Une plus grande implication des États-Unis dans les affaires du monde irait de pair avec un « usage approprié » de la force, en dépit des fiascos des terribles précédents afghan et irakien qui ont tant contribué à l’émergence de Daech. Le nouveau secrétaire d’État, Antony Blinken, est en pointe sur le sujet. Il n’a pas hésité à publier en 2019 une sorte de manifeste dans le « Washington Post » avec Robert Kagan, le chef de file des néoconservateurs du Nouveau Siècle américain. « Les erreurs commises en Irak et en Afghanistan, insistent le démocrate et le républicain, ne doivent pas nous conduire à désinvestir ce terrain, car la force est nécessaire et complémentaire d’une diplomatie effective ». Sans capacités à « projeter la puissance appropriée, aucune paix ne pourra être négociée, encore moins imposée » (2). Le message ne vaut pas seulement pour Pékin, il s’adresse à la planète entière, aux pays de l’ex-arrière-cour latino-américaine, comme à Moscou ou à l’Europe.
L’otan, « bras armé du monde libre »
Pour mettre en œuvre un tel déploiement de la puissance, des moyens considérables sont indispensables. D’où la volonté d’embarquer dans l’aventure des alliés qui consentent d’abord à mettre davantage la main à la poche. La pression sur les membres de l’Otan pour qu’ils augmentent leurs dépenses militaires jusqu’à 2 % de leur PIB d’ici à 2025 ne va donc pas se relâcher. Moins assortie d’un chantage comme sous Donald Trump, qui menaçait de retirer le prétendu « parapluie militaire » des États-Unis à tous ceux qui ne s’exécuteraient pas, elle devrait prendre une dimension plus globale. L’équipe Biden veut décliner un renforcement du lien avec ses alliés européens sur les plans autant sécuritaire et politique qu’économique en y incorporant la résurrection du traité de libre-échange transatlantique.
Le couple Blinken-Kagan plaidait dans le « Washington Post » pour une Otan bras armé du « monde libre », élargissant son champ d’action à l’ensemble du globe. (3) Reste à convaincre les « partenaires ». La nouvelle administration compte beaucoup sur Berlin, où les traditions atlantistes sont très ancrées. Même si les principaux clients des grands groupes exportateurs germaniques sont désormais… chinois. Ce qui pourrait alimenter d’intempestives contradictions. Quant à la France d’Emmanuel Macron, elle plaide pour une « Europe de la défense » « parfaitement complémentaire de l’Otan ». Difficile d’être mieux aligné sur les projets transatlantiques de Joe Biden.
(1) « Why America Must Lead Again » (Pourquoi l’Amérique doit diriger de nouveau). Les engagements de politique extérieure du président Biden.
(2) Blinken-Kagan : manifeste de politique étrangère alternative publié dans le « Washington Post » du 4 janvier 2019.
(3) Blinken-Kagan, ibid.